Une Saison en Enfer est très certainement le texte le plus connu d’Arthur Rimbaud. Et pour cause ! C’est d’ailleurs le seul ouvrage dont il ait contrôlé la publication. Mais si l’on commente très fréquemment le texte liminaire, « Jadis, si je me souviens bien… », ainsi que la fameuse « Alchimie du verbe », il est en revanche beaucoup plus rare de s’intéresser à « Vierge folle« . C’est pourquoi je voudrais vous faire découvrir ce poème aujourd’hui.
Un article de la rubrique « Le poème d’à côté »

L’une des ambitions de ce blog est d’aider à faire connaître la poésie moderne et contemporaine. Avec la rubrique « Le poème d’à côté », je vous propose de découvrir un poème initialement paru juste avant ou juste après un poème très célèbre. Il s’agit en somme de tourner la page, afin de découvrir des poèmes moins connus, histoire de renouveler les anthologies. Vous accéderez à la liste des articles de cette rubrique en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Un poème de la Saison en Enfer
Par sa forme discontinue, par sa brièveté, par le caractère très allusif des nombreuses références qui y apparaissent, par la force véhémente de bien des affirmations, la Saison en Enfer apparaît comme un texte difficile d’accès. On n’a pas dit grand-chose en le définissant par le terme de « poème en prose », tant celui-ci est vague et a pu être prêté à des pratiques poétiques très différentes. Ajoutons qu’il s’agit là d’un texte éminemment polyphonique, où le poète fait dialoguer plusieurs voix, sans que l’on parvienne toujours à déterminer si le poète parle en son nom propre, donc que les affirmations proférées sont à mettre sur son compte, ou s’il fait parler un personnage, donc que les propos ne sont pas personnellement assumés.
Comme l’indiquait très justement Jean-Marie Seillan dans son cours d’agrégation sur Rimbaud, on peut se repérer dans la Saison en Enfer en considérant que s’y juxtaposent, et même s’entrelacent constamment, trois dimensions : une dimension autobiographique (mais celle-ci est piégée), une dimension esthétique (mais avec beaucoup de distance et d’ironie), et une dimension historique (le poète se pensant lui-même et pensant son époque en rapport avec le passé comme avec l’avenir).
Vierge folle est le premier des « Délires », il précède immédiatement la fameuse « Alchimie du Verbe » également intitulée « Délires II ». Ce texte se prête donc parfaitement à la rubrique « Le poème d’à côté ». Cette section « Délires » est la plus longue de l’ouvrage, et elle occupe une position centrale. Si « Délires II » est un texte avant tout méta-poétique, où Rimbaud revient sur son expérience poétique, dans une sorte de réquisitoire distancié et ironique qui pourrait bien se lire malgré tout comme un plaidoyer, « Délires I » paraît davantage narratif, mettant en scène une polyphonie d’énonciateurs.
Il faut, je crois, s’arrêter sur ce titre de « Délires ». Que Rimbaud ait donné ce titre à « Vierge folle », cela peut vouloir indiquer qu’il ne faut pas prendre au sérieux ce texte, qui ne serait qu’un délire (Voltaire, par exemple, parlait lui-même de « couillonnerie » pour évoquer certains de ses propres ouvrages). Il peut aussi s’agir d’une façon de revendiquer le caractère incohérent du discours. En somme, Rimbaud ne prétend pas construire un texte rationnel, il n’essaie pas d’expliquer ou de raconter, il écrit comme ça lui chante. Être conscient de ce « délire », c’est précisément avoir du recul, et considérer ce texte avec distance. Rimbaud revendique vraisemblablement ce délire, terme qui peut être pris de façon positive, si l’on songe à ce que l’Antiquité parlait de fureur divine (furor divinus) à propos de l’enthousiasme du poète…
Le ton de la confession
Le texte commence ainsi :
Écoutons la confession d’un compagnon d’enfer :
« Ô divin Époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdue. Je suis soûle. Je suis impure. Quelle vie !
« Pardon, divin Seigneur, pardon ! Ah ! pardon ! Que de larmes ! Et que de larmes encore plus tard, j’espère !
« Plus tard, je connaîtrai le divin Époux ! Je suis née soumise à Lui. — L’autre peut me battre maintenant !
« À présent, je suis au fond du monde ! Ô mes amies !… non, pas mes amies… Jamais délires ni tortures semblables… Est-ce bête !
« Ah ! je souffre, je crie. Je souffre vraiment. Tout pourtant m’est permis, chargée du mépris des plus méprisables cœurs.
« Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter vingt autres fois, — aussi morne, aussi insignifiante !
Ce qu’il faut avant tout noter, c’est que le poète donne la parole à un « compagnon d’enfer ». Il ne parle donc pas en son nom propre, il fait parler un personnage, avec tout ce que cela implique de distance par rapport aux propos. Le terme de « compagnon d’enfer » renvoie au titre de l’ouvrage : le « je » (qui est aussi un personnage plutôt que la personne même du poète) a passé une « saison » en enfer et y a rencontré un codétenu auquel il donne la parole. Ces propos sont d’emblée qualifiés par le terme de « confession », qui renvoie à une pratique, plus courante à l’époque qu’aujourd’hui, consistant pour un croyant à être entendu en privé par un curé, afin de lui avouer ses fautes, en espérant trouver conseil et pardon.
Aussi ne s’étonnera-t-on pas de voir pulluler dans ce texte les phrases exclamatives et les interjections en « Ah ! » qui intensifient l’expression de la souffrance. Il y a quelque chose d’emphatique dans cette confession, qui montre bien que Rimbaud cherche à ridiculiser son personnage, excessivement larmoyant. À force d’en rajouter dans le pathos, dans la déploration, dans l’expression paroxystique de la souffrance, celle-ci ne nous touche plus. Rimbaud nous montre donc un personnage éploré, faible, convaincu de sa faute, persuadé d’être au « fond du monde », souffrant les pires « tortures » du remords, mais tellement excessif qu’on en vient à douter de sa raison : on comprend mieux l’adjectif « folle » du titre.
« L’Époux infernal »
Quelle est la raison de tant de tourments ? Le personnage s’en explique dans la suite du poème. Poursuivons donc notre lecture.
« Je suis esclave de l’Époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C’est bien ce démon-là. Ce n’est pas un spectre, ce n’est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, — on ne me tuera pas ! — Comment vous le décrire ! je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j’ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez bien !
« Je suis veuve… — J’étais veuve… — mais oui, j’ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette !… — Lui était presque un enfant… Ses délicatesses mystérieuses m’avaient séduite. J’ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent il s’emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le Démon ! — C’est un Démon, vous savez, ce n’est pas un homme.
Pour comprendre ce passage, il faut bien garder à l’esprit que le « je » qui parle est la « Vierge folle ». Autrement dit, Rimbaud fait parler un personnage. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension dialogique.
Il est possible de voir, dans cette « Vierge folle », une image de Verlaine, et dans « l’époux infernal », une image de Rimbaud. Mais il s’agit précisément d’images, et non des personnes réelles. Il y a sans doute une part de réalité autobiographique dans cette image d’un Rimbaud démoniaque et dominateur, et d’un Verlaine féminisé et soumis, séduit par les « délicatesses mystérieuses » d’un Rimbaud presque « enfant » : on sait combien la relation des deux poètes fut orageuse, au point de se terminer par un coup de pistolet. Rimbaud prend sans doute plaisir à se moquer de son compagnon en le peignant en vierge éplorée. Toujours est-il que la relation apparaît comme inégale, avec un Verlaine qui aurait tout sacrifié pour Rimbaud (« J’ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre »).
Ce faisant, Rimbaud joue avec l’imaginaire chrétien. Le terme même de « vierge folle » renvoie à la « Parabole des vierges sages » que l’on trouve dans l’Évangile selon Matthieu. L’expression d' »époux infernal » peut faire penser au fait que, dans le Cantique des Cantiques, la relation de l’individu avec Dieu est représentée de façon métaphorique comme une sorte de mariage, Dieu apparaissant comme l’Époux divin. Ici, la « vierge folle » aurait au contraire épousé le Diable…
Un discours dans le discours
Au sein de ce discours de la Vierge folle, Rimbaud insère un discours rapporté qui est celui de « l’Époux infernal ». Autrement dit, dans ce passage, ce serait donc Rimbaud qui s’exprimerait. Impossible, cependant, de ne pas tenir compte de cette mise en abyme, qui place les propos à distance.
« Il dit : « Je n’aime pas les femmes. L’amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté : il ne reste que froid dédain, l’aliment du mariage, aujourd’hui. Ou bien je vois des femmes, avec les signes du bonheur, dont, moi, j’aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d’abord par des brutes sensibles comme des bûchers… »
« Je l’écoute faisant de l’infamie une gloire, de la cruauté un charme. « Je suis de race lointaine : mes pères étaient Scandinaves : ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. — Je me ferai des entailles partout le corps, je me tatouerai, je veux devenir hideux comme un Mongol : tu verras, je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramperais et me tordrais sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai… » Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec lui ! — Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues ou dans des maisons, pour m’épouvanter mortellement. — « On me coupera vraiment le cou ; ce sera dégoûtant. » Oh ! ces jours où il veut marcher avec l’air du crime !
L’affirmation « Je n’aime pas les femmes » se lit comme une façon pour Rimbaud, certes dissimulée dans le jeu fictionnel, de revendiquer son homosexualité. Aux conventions de l’amour bourgeois (« mariage »), Rimbaud oppose une conception non seulement plus libre, mais aussi plus intense, voire violente (« dévorées tout d’abord par des brutes sensibles comme des bûchers »). Dans une sorte d’inversion des valeurs traditionnelles, « l’infamie » devient « une gloire », et la « cruauté » devient « un charme ». Les comparaisons aux « Scandinaves » et aux « Mongols » rejoignent l’assimilation aux « ancêtres gaulois » apparue dans les premières pages de la Saison : le poète revendique son « Mauvais sang », il se peint en bad boy cruel, avide de violence.
Ange ou démon ?
Si Rimbaud se plaît à se décrire sous des traits démoniaques, il apparaît aussi comme une figure angélique :
« Parfois il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d’une mère méchante pour les petits enfants. — Il s’en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. — Il feignait d’être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. — je le suivais, il le faut !
Voici donc un Rimbaud « attendri », attentif aux misères de ce monde, pleurant face aux malheurs d’autrui. La phrase « Il relevait les ivrognes dans les rues noires » caractérise le comportement d’un saint. Sa sévérité même de « mère méchante » s’expliquerait avant tout par sa « pitié ». Ses « gentillesses » sont comparées à celles d’une « petite fille au catéchisme ». Certes, tout ceci est modalisé par l’expression « il feignait », qui laisse penser qu’il s’agit là davantage d’une posture que d’un mouvement spontané. Il n’en reste pas moins que « l’époux infernal », donc Rimbaud, apparaît sous des traits angéliques.
La compagne d’un génie incompris
Le passage qui suit fait le portrait d’un génie, d’un être d’exception, dont les pensées et les projets ne sont pas ceux du commun des mortels. Il apparaît, simultanément, qu’il est bien difficile d’être la compagne d’un tel génie.
« Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s’entourait ; vêtements, draps, meubles : je lui prêtais des armes, une autre figure. Je voyais tout ce qui le touchait, comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me semblait avoir l’esprit inerte, je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises : j’étais sûre de ne jamais entrer dans son monde. À côté de son cher corps endormi, que d’heures des nuits j’ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s’évader de la réalité. Jamais homme n’eut pareil vœu. Je reconnaissais, — sans craindre pour lui, — qu’il pouvait être un sérieux danger dans la société. — Il a peut-être des secrets pour changer la vie ? Non, il ne fait qu’en chercher, me répliquais-je. Enfin sa charité est ensorcelée, et j’en suis la prisonnière. Aucune autre âme n’aurait assez de force, — force de désespoir ! — pour la supporter, — pour être protégée et aimée par lui. D’ailleurs, je ne me le figurais pas avec une autre âme : on voit son Ange, jamais l’Ange d’un autre — je crois. J’étais dans son âme comme dans un palais qu’on a vidé pour ne pas voir une personne si peu noble que vous : voilà tout. Hélas ! je dépendais bien de lui. Mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche ? Il ne me rendait pas meilleure, s’il ne me faisait pas mourir ! Tristement dépitée, je lui dis quelquefois : « je te comprends. » Il haussait les épaules.
Rimbaud s’entoure d’un monde qui n’est accessible qu’à lui-même. Ce « décor », c’est sans doute celui que l’imagination féconde du poète n’a de cesse de créer. Mais le poète « réservait la traduction ». Aussi la Vierge Folle était « sûre de ne jamais entrer dans son monde ». Rimbaud apparaît ainsi comme un génie inaccessible, dont les « actions étranges et compliquées » demeurent incompréhensibles. L’antéposition de l’adverbe « jamais » dans la phrase « Jamais homme n’eut pareil vœu » érige le poète en figure exceptionnelle, unique au monde.
Il n’est pas facile d’être la fidèle compagne d’un tel génie. On a l’impression que c’est un Watson qui parle de son Sherlock Holmes. La narratrice éprouve une admiration sans bornes pour ce génie, mais on sent qu’elle est chèrement payée. « Supporter » Rimbaud apparaît comme une gageure. Les phrases « J’en suis la prisonnière », « Je dépendais de lui » montrent l’enfermement de la « vierge folle » dans un couple orageux, qui risque de la faire « mourir ». Le paragraphe se termine avec ce haussement d’épaules qui marque explicitement toute l’indifférence de « l’époux infernal » pour la « vierge folle », de Rimbaud pour Verlaine.
Ce faisant, apparaissent certains aspects essentiels de la poétique de Rimbaud : la volonté de « changer la vie », de « s’évader de la réalité ». On sait combien « Partir » comptait pour Rimbaud. On mesure aussi son aversion pour les conventions sociales et les normes bourgeoises, qu’il n’aura eu de cesse de fustiger dans ses poèmes (notamment dans « À la musique »). Rimbaud apparaît même ici comme « un sérieux danger dans la société ». On sait que, invité à des cénacles poétiques, il se comportait davantage en trublion qu’en poète inspiré.
Cruelle douceur !
« Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse, et me trouvant plus égarée à mes yeux, — comme à tous les yeux qui auraient voulu me fixer, si je n’eusse été condamnée pour jamais à l’oubli de tous ! — j’avais de plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers et ses étreintes amies, c’était bien un ciel, un sombre Ciel, où j’entrais, et où j’aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j’en prenais l’habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le Paradis de tristesse. Nous nous accordions. Bien émus, nous travaillions ensemble. Mais, après une pénétrante caresse, il disait : « Comme ça te paraîtra drôle, quand je n’y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n’auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t’y reposer, ni cette bouche sur tes yeux. Parce qu’il faudra que je m’en aille, très-loin, un jour. Puis il faut que j’en aide d’autres : c’est mon devoir. Quoique ce ne soit guère ragoûtant…, chère âme… » Tout de suite je me pressentais, lui parti, en proie au vertige, précipitée dans l’ombre la plus affreuse : la mort. Je lui faisais promettre qu’il ne me lâcherait pas. Il l’a faite vingt fois, cette promesse d’amant. C’était aussi frivole que moi lui disant : « je te comprends. » […]
La « vierge folle » est en permanence en attente de témoignages d’amour que son compagnon ne peut réellement lui apporter. Si elle appartient à son époux, lui ne saurait se contenter de cet amour. Il est comme appelé ailleurs, et il annonce le caractère inéluctable de la rupture. « Il faut que j’en aide d’autres » : on a l’impression, là encore, d’un ange appelé à d’autres missions. Dans le Christianisme, il y a l’idée que le Christ laisse seuls ses fidèles, dans une ultime leçon qui est celle de l’autonomie, et c’est un peu cette idée qui apparaît sous la plume de Verlaine :
[…] « Un jour peut-être il disparaîtra merveilleusement ; mais il faut que je sache, s’il doit remonter à un ciel, que je voie un peu l’assomption de mon petit ami ! »
Drôle de ménage !
*
Cette première partie des Délires, si elle n’est pas la plus connue de la Saison en Enfer, est néanmoins intéressante à plus d’un titre. D’abord, elle décrit, à mots couverts, et sous le miroir déformant de la fiction, quelque chose de la relation entre Rimbaud et Verlaine. Il me semble que cette dimension autobiographique ne peut être ignorée, même si certains commentateurs ne souscrivent pas à cette interprétation. Les autobiographèmes sont, à mon sens, suffisamment nombreux pour que cette lecture soit convaincante. Mais il va de soi que Rimbaud ne parle jamais au premier degré, son texte est constamment marqué par une distance ironique qui impose de rappeler qu’il s’agit avant tout de deux personnages, la « vierge folle » et « l’époux infernal », bien plus que de deux personnes réelles, Verlaine et Rimbaud. On assiste ainsi à une mise en scène, qui fait apparaître une relation inégale et orageuse, où un génie incompris, doux et cruel, malmène sa bien aimée, soumise et prisonnière. Ah, qu’il ne doit pas être facile d’aimer un génie !
Abonnez-vous gratuitement à « Littérature Portes Ouvertes » !
Recevez gratuitement, par e-mail, l’actualité des différentes publications du blog.
Image d’en-tête : Wikipédia.







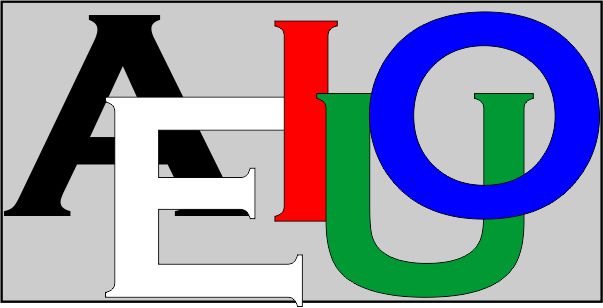
décidément je n ‘arriverai jamais apprécier cette prose : Verlaine m ‘enchante souvent mais
Rimbaud n ‘arrive pas à m ‘enthousiasmer j ‘avoue mon incompétence devant ce qui me semble – à tort sans doute – un tourbillon de mots
J’aimeAimé par 1 personne
PASCALE (VIA FACEBOOK) : La relation Verlaine / Rimbaud fut destructrice, vous analysez cela avec brio. Mais finissons sur une note positive, sur le dernier vers du dernier poème, »Adieu » : « (…) il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. » D’aucuns y ont vu une rédemption, j’aime y croire
J’aimeAimé par 1 personne
J’aime énormément ce texte et vos analyses ! Merci beaucoup !!
J’aimeAimé par 1 personne
Merci à vous !
J’aimeJ’aime