À quelle autre adresse un poète pourrait-il rêver d’habiter ? Pour Jean-Michel Maulpoix, le poète habite Rue des fleurs. Quelques années après Boulevard des Capucines, ce nouveau titre suggère à lui seul tout un univers, urbain et campagnard à la fois. Promenons-nous, à notre tour, le long de cette rue des fleurs…
Le poète au cœur de la ville
Avec ce dernier livre, tout récemment paru, Jean-Michel Maulpoix affirme que la place du poète est résolument parmi ses semblables. À l’instar d’un Baudelaire ou d’un Apollinaire, il circule dans la ville, et en rapporte des images. Significativement, la première section du recueil s’intitule « Banlieue pauvre ». Ce titre, à lui seul, montre bien que le but de la poésie n’est pas de masquer les souffrances humaines sous de belles paroles, des métaphores élégantes et des rimes sonores. Au cœur de la cité, le poète donne des nouvelles de ses semblables humains, sans rien cacher de leurs souffrances et de leurs misères.
« Cœur fripé l’amer du sommeil dans la bouche
Tous ensemble ils arrivent par le tram de sept heures
Le bleu sent la javel la terre sent le goudron
Palmiers de ferraille et palmiers de suie
Des débris d’images couvrent leurs paupières
Les poulies du ciel grincent à grand bruit
Avançant sur le quai jusqu’à l’extrémité de la fatigue
Ils n’iront pas plus loin que ce monde-ci ce wagon-là
Du soir qui se lève au jour qui se couche. » (p. 15)
Les allitérations en [r] soulignent le malaise de cette population anonyme, aliénée par le travail, perdue dans un paysage minéral et métallique. Si ces travailleurs se déplacent, cela reste dans un cadre fermé : « ils n’iront pas plus loin ». Rimbaud l’affirmait déjà : « On ne part pas ». Le dernier vers, par l’inversion des subordonnées relatives, instaure un univers fermé. Le « bleu », la « terre » et le « ciel » auraient pu ouvrir sur un horizon plus large, mais ces notations sont systématiquement associées à des réalités plus triviales : la « javel », le « goudron », les « poulies ». C’est ici un monde sali par l’industrie que décrit le poète, un monde qui ruine les paysages et aliène les travailleurs.
Un mouvement de fond dans l’œuvre de Jean-Michel Maulpoix est celui de la dissonance, de l’inquiétude, du malaise. Le poème que je viens de citer participe clairement de cette dynamique. On peut dire, pour une part, que l’ambition du poète est de mettre en mots et en poèmes la condition claudicante de l’homme contemporain, désabusé, mélancolique, constatant avec amertume que l’idéal tant rêvé n’advient pas ou peu.
Cette « banlieue pauvre » fait écho à une autre section du même titre, dans La Matinée à l’anglaise, l’un des premiers recueils du poète, paru en 1981. On peut y voir, peut-être, une façon de remarquer que, de 1981 à 2022, donc en l’espace de quarante ans, les banlieues sont toujours aussi pauvres, toujours aussi peuplées de figures anonymes et précaires.
« C’est une ville en ruine où les gros autobus débarquent le mercredi leurs équipages d’enfants tristes, comme un éboulis de rêves en vitrine du petit magasin de couleurs où l’on vend des poupées de laine et des oiseaux bleus en carton.
Beaucoup de bruits sans importance dans les rues qu’on ne connaît guère et les maisons qu’on dirait bâties un même soir de quelques pierres, cahin-caha. Les tours arborent des robes noires, profondes et pailletées de diamants. Ce sont les joyeuses veuves de l’amour. »
La Matinée à l’anglaise, Seghers, 1981, p. 52.
Mais l’art de Jean-Michel Maulpoix réside dans la capacité de trouver de petits détails qui portent en eux, malgré tout, quelque chose qui fait qu’on ne cède pas complètement au désespoir. C’est un « ballon rouge » qui apporte un point de couleur dans le gris, c’est un « petit pan de mur jaune » emprunté à Proust, détail pictural de la Vue de Delft de Vermeer.
« On voit pourtant parfois flotter un ballon rouge
Un mètre au-dessus de la tête d’une Marjolaine
Au-delà c’est pour les fumées les antennes
Rarement pour les oiseaux ou les anges
On entend le soir des musiques aux portes
Et toutes les fenêtres sont bleues à partir de huit heures
On écoute on regarde on n’a rien à se raconter
Mais on cherche toujours un petit pan de mur jaune. » (p. 14)
L’adverbe « pourtant » marque le décrochage, l’envolée. Malgré tout ce qui pèse, il y a donc de la légèreté. Jean-Michel Maulpoix, après Baudelaire, cherche à extraire la beauté du trivial. C’est au sein d’un « horizon d’ardoise et de crassier » (Une histoire de bleu, p. 87) que le poète repère les signes d’apaisement, aussi subtils soient-ils. Il ne s’agit jamais d’un accès plein et définitif à l’infini ou à l’absolu. Ce n’est jamais qu’un ballon rouge. Si les « fenêtres sont bleues », c’est simplement que les gens regardent la télévision qui renvoie une lumière bleutée. Le prosaïsme n’est jamais loin. On est dans cet entre-deux-là. « On cherche toujours » : c’est une quête sans fin.
Cette humanité précaire qui apparaît au fil des pages résonne avec l’actualité la plus brûlante comme avec notre quotidien le plus actuel, en dépit même des nombreuses années qui séparent cette réécriture de leur première naissance : les travailleurs, les émigrés, les enfants du centre aéré, les prostituées sur le trottoir, les malades et les brancardiers de l’hôpital… Tous ces gens-là : nos semblables, nos frères, nos compagnons d’exil.
« Ceux qui n’ont pas de visage
Balbutient dans la nuit
Ils mâchent quelques miettes de pain bleu
Tombées d’un ciel vide » (p. 53)
Écrire, réécrire
De nombreux poèmes de Rue des fleurs sont la réécriture de poèmes antérieurs. Ce mouvement de réécriture est fréquent chez Jean-Michel Maulpoix. Cette pratique fait partie de celles que j’ai rassemblées dans ma thèse sous le terme de « basse obstinée » : les musiciens savent que ce terme désigne la reprise constante d’un même motif fondamental à la basse, pendant que varie la mélodie principale. Ce mouvement obstiné, à l’image de l’inlassable ressac, conduit le poète à reprendre, encore et encore, les mêmes motifs, les mêmes interrogations inquiètes, la même quête d’apaisement. Ce mouvement est souvent allé du vers à la prose. Il va, cette fois-ci, de la prose au vers. En voici un exemple :


On peut voir dans cette réécriture un refus de l’ampleur. Les retours à la ligne brisent l’allant de la prose. La souffrance des personnages, simplement nommés par le pronom « ils », n’en paraît que plus vide. La suppression de la comparaison au tableau de Chirico retranche toute dimension onirique et symbolique à la scène. Ne reste que ce coin de rue, ce « nulle part », ce no man’s land, dérisoire abri de ces personnages anonymes.
Collecter des fragments sereins
Face à ce monde toujours plus angoissant, l’urgence est à la collecte d’instants sereins, selon une logique toute épicurienne. Depuis longtemps maintenant, les poètes ne se prétendent plus prophètes, et ils n’entendent pas faire jaillir de leur plume des solutions toutes faites, qui risqueraient bien de n’être qu’écrans de fumée et artifices de rhétorique.
Dans une note en fin d’ouvrage, Jean-Michel Maulpoix rappelle que l’anthologie, le florilège sont étymologiquement des bouquets de fleurs. Rue des fleurs peut ainsi se lire comme une façon de recueillir, dans un livre, de petits fragments d’humanité, des instants sereins, des morceaux de vie un peu plus paisibles, à la façon, si l’on veut, des fleurs que l’on faisait sécher dans de gros dictionnaires. Carpe diem.
C’est cependant en automne que se situe la deuxième section du jardin. Nous sommes donc bien loin de toute reverdie. C’est une saison de Toussaint, une arrière-saison morne et triste, où l’on fréquente les cimetières et où l’on se rend compte du peu de choses que nous sommes. Aussi faudrait-il parler d’un épicurisme inquiet, très conscient de la fragilité de l’existence et du caractère inexorable de la mort.
« Peu d’espoir l’aube
A brisé par mégarde une étoile
Voilà que les mots n’ont plus de désir
L’heure est passée depuis longtemps
Et pourtant il fait doux
Dans l’embellie du soir
Aux étages différents
De nos vies. » (Rue des fleurs, p. 38)
La mort, dit-il
Le premier poème de la deuxième section s’intitule « Au cimetière ». Titre qui pourrait être celui d’un tableau, d’une scène. Lui aussi est le résultat de nombreuses réécritures. Je me permets d’en citer la première strophe, parce que je la connais presque par cœur, tant elle correspond à des aspects qui me semblent fondamentaux dans la poésie de Jean-Michel Maulpoix.
« L’âme disais-tu est ce vent aigre ou ce verre vide
Ces pas d’insecte ces ustensiles de fer-blanc
un drap de lit que l’on déplie que l’on replie
À l’heure de naître puis de mourir
Nul ne rentrera sain et sauf de sa propre vie » (Rue des fleurs, p. 29)
L’âme, disait-elle, est ce vent aigre,
ou ce verre vide, ces pas d’insecte, ces ustensiles de fer blanc, la curieuse
politique de l’amour, la miséricorde
infinie du ciel et de la cendre, un drap de lit que l’on déplie, que l’on replie, à l’heure de naître puis de mourir. Nul ne rentrera sain et sauf de sa propre vie.
J.-M. Maulpoix, L’écrivain imaginaire (1994)
L’âme, disais- tu, est ce vent aigre, ou ce verre vide. Ces pas d’insectes, ces ustensiles de fer blanc. Un drap de lit que l’on déplie, que l’on replie, à l’heure de naître puis de mourir.
J.-M. Maulpoix,
Chutes de pluie fine (2002)
L’âme, disais-tu, est ce vent aigre, ou ce verre vide, ces pas d’insecte,
ces ustensiles de fer blanc
L’âme est un drap de lit que l’on déplie, que l’on replie, à l’heure de
naître puis de mourir
Nul ne rentrera sain et sauf de sa propre vie
J.-M. Maulpoix,
Le Monologue de l’encrier (2005)
L’âme apparaît non pas ici comme un souffle vital, mais comme un « vent aigre », ce vent d’automne porteur de froid. Elle n’est pas un plein, mais un vide. Elle n’est pas qualifiée en termes spirituels, mais à travers des objets du quotidien. Jean-Michel Maulpoix refuse toute emphase, comme toute adhésion à un dogme préétabli. Il met en évidence la fragilité de l’existence, à travers l’identification de deux linges : les langes de notre naissance et le linceul de notre mort. Entre les deux, c’est comme s’il n’y avait qu’un interstice, un simple tiret entre deux dates, vite réduit à néant.
« C’est simplement la vie
Tout ordinaire n’est-ce pas
Qui par morceaux les a défaits
Brouillant d’une même fatigue leurs traits
Leurs désirs
Et leurs grandes espérances » (p. 54)
De la mort, Jean-Michel Maulpoix ne fait pas un drame. Refusant constamment tout excès de pathos, ses mots portent la tragédie ordinaire de la condition humaine, avec une mélancolie douce-amère aux tons pastel. Pas de rage ni de fureur, mais l’acceptation du fait que la souffrance fait partie de la vie.
« Il faut apprendre à faire au mieux
Avec ce rien que l’on est
Pour quelque temps encore » (p. 62)
C’est ici une morale de l’existence qui nous est proposée. Non pas une leçon de sagesse, mais simplement une façon de bricoler avec la vie, avec ce qu’on a, comme on peut, sans position surplombante, s’arrangeant avec le fardeau de chaque jour, non sans une conscience aiguë de la fragilité de l’existence et du caractère inexorable de la mort. Le temps fait son œuvre cruelle, il nous prive d’êtres chers.
La pandémie est évoquée au détour d’un vers : « Un virus inconnu a frappé » (p. 66). Jean-Michel Maulpoix n’en dit pas plus, comme pour rester à distance de cet épisode qui a si fortement bousculé nos existences. « Le réel me pousse dans le dos » (p. 66), dit-il. Le poète n’a pas voulu parler de cela, même s’il est probable que ces temps troublés aient ajouté à la mélancolie du poète.
« Je n’irai plus très loin
Avec cette encre-là
D’une couleur si pauvre
Qu’elle n’éclaire plus rien
Et il n’est pas certain qu’en parler soit utile » (p. 63)
Écrire, malgré tout
Écrire, dès lors, ne saurait aller de soi. Face à la mort, à l’inquiétude, à la vue des souffrances de ses semblables humains, le poète ne saurait laisser aller sa plume à de plaisantes rêveries. « Je parle voyez-vous une autre langue / Où les phrases sont plus courtes » (p. 62). Le choix du vers libre marque le refus de l’ampleur de la prose. Il faut savoir que la majeure partie de l’œuvre de Jean-Michel Maulpoix s’écrit en prose, et que le poète affectionne les énumérations, les phrases longues, les périodes aux mouvements rythmés. Le choix du vers est donc particulièrement significatif d’une volonté de marquer l’inquiétude, la tristesse, le dénuement.
Jean-Michel Maulpoix emprunte à Rimbaud le titre de « Comédies de la soif ». Mais son poème s’apparente aussi à la Saison en Enfer, en ce que le poète y fait le récit rétrospectif et le bilan de sa propre pratique poétique :
« Ecrivant (naguère) des poèmes
J’attendais que la langue
Se mît à couler
Comme un ruisseau d’eau claire
Je guettais, j’espérais encore
Mais ce n’était jamais jamais
Qu’un mince filet de signes sombres
Que pouvait-il donner à boire ? » (p. 56)
Ce poème donne à lire une conception désenchantée de la poésie. Jean-Michel Maulpoix y oppose constamment une naïveté passée et une lucidité présente, jusqu’à donner l’impression qu’il ne lui est désormais plus guère possible d’écrire de la poésie. La comparaison à un « ruisseau d’eau claire » contraste avec le tarissement présent de cette source. Le poète reste donc avec sa soif : « Que pouvait-il donner à boire ? »
La résignation n’est cependant pas totale. Il y a bien quelques signes d’espoir, quelques instants paisibles, aussi fugitifs soient-ils. C’est à l’impératif que le poète s’exhorte : « À genoux dans la nuit / Cherchons les dieux perdus dans l’herbe » (p. 58). Le poète reste attentif à la beauté des fleurs. Il célèbre la capacité de la gentiane à s’élever dans le froid « en dépit de la minceur de ses racines » (p. 76). Il s’obstine : « Sans preuves je cherche encore » (p. 77). Il place en fin de poème ce vers davantage positif : « Il reste quelques puits d’eau claire » (p. 77). Il « resterait à raconter », dit-il, l’histoire des fleurs (p. 78) : des mots encore peuvent être écrits, des phrases peuvent être prononcées et des histoires être contées. Aussi fragile que soit l’existence, aussi futile que puisse parfois paraître l’exercice d’écrire, la poésie n’a pas dit son dernier mot.
« Je lie en bouquets ou en gerbes les preuves de ma disparition
Et je projette sur vos cheveux des pétales de cerisiers blancs
Afin que se fortifie dans vos cœurs la pensée de l’amour » (p. 65)
*
Puisse cette Rue des fleurs, à votre tour, vous accompagner dans vos promenades. Qu’elle vous soit un refuge où vivre s’allège un peu. S’il vous venait l’envie d’en cueillir quelques bouquets, vous trouverez le volume aux éditions du Mercure de France. N’hésitez pas aussi à lire mes articles consacrés à d’autres ouvrages de Jean-Michel Maulpoix. Et restez au courant des publications du blog en vous y abonnant gratuitement !

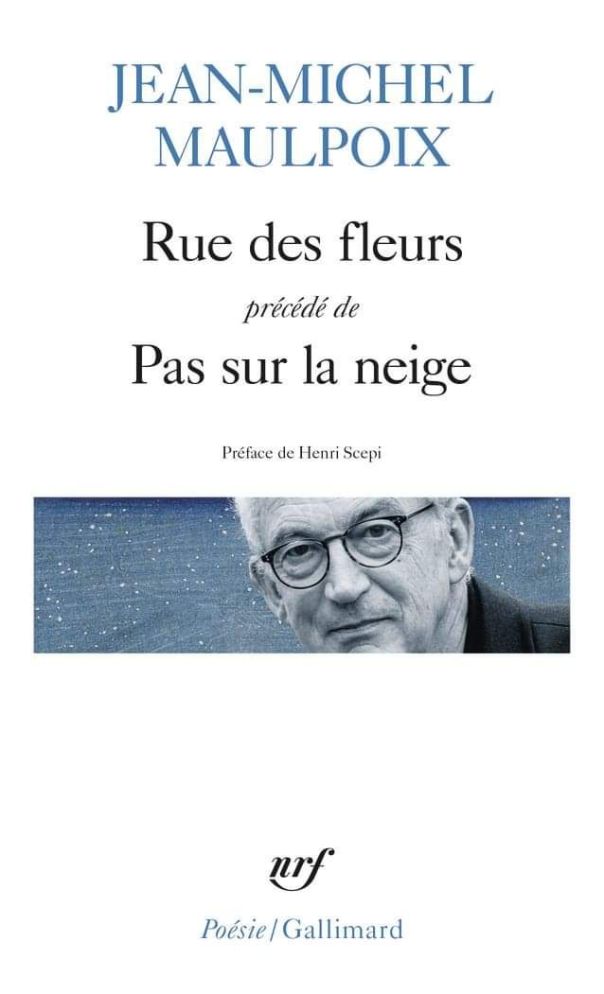








MERCI pour ces beaux extraits de la « Rue des fleurs » Je comprends pourquoi Ph. Jaccotet aimait ce poète que vous nous faites mieux connaître par ce recueil
J’aimeAimé par 1 personne
Merci à vous pour ce commentaire 😉
J’aimeJ’aime